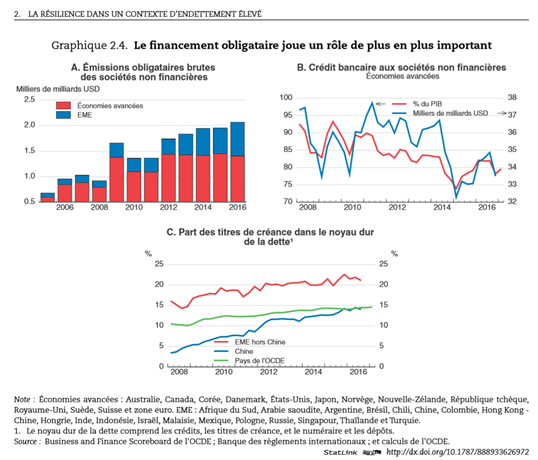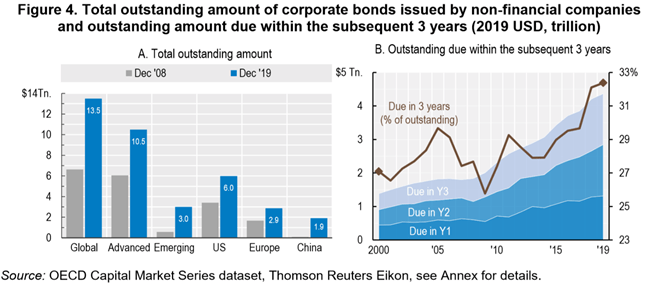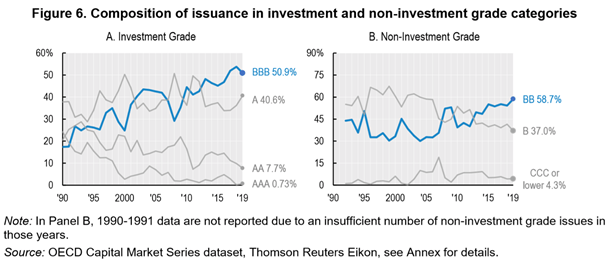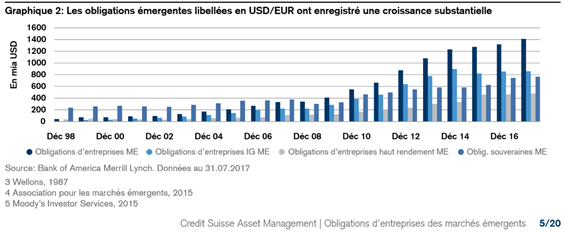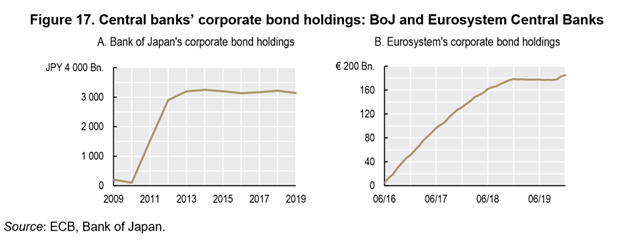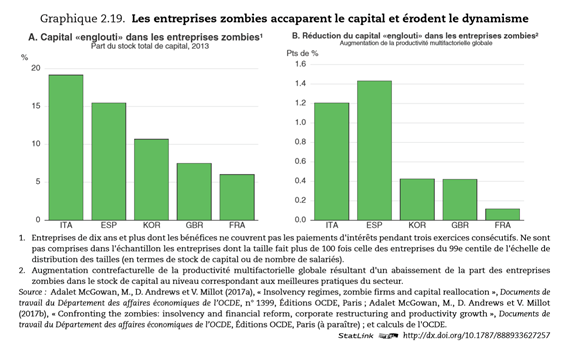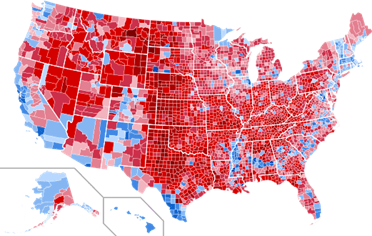Par Pierre Geraud, étudiant en Master Stratégies territoriales à Sciences Po
Constituant l’une des quatre grandes catégories de ressources des collectivités territoriales (avec les concours de l’Etat, l’emprunt et les produits issus du patrimoine et des services publics locaux), la fiscalité locale représente deux tiers des recettes des collectivités, soit environ 165 milliards d’euros en 2022 et regroupe d’une part les impôts et taxes locaux et d’autre part la fiscalité nationale affectée. Toutefois, la récente vague d’augmentation des taxes foncières dans certaines communes confrontées à une situation budgétaire difficile comme à Paris (+ 52% en 2023) a relancé le débat sur le financement des collectivités locales, dans un contexte où les collectivités doivent faire face à la suppression de taxes locales (taxe d’habitation, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises). En outre, les collectivités ont été confrontées à une hausse structurelle de leurs dépenses avec l’élargissement de leurs compétences au gré des actes de la décentralisation, mais également conjoncturelles pendant la période inflationniste 2022-2023.
Les collectivités locales sont dotées d’une autonomie financière en vertu de la Constitution :
Le principe de libre-administration (Constitution du 4 octobre 1958, art 72) dont dispose les collectivités induit une autonomie financière (Constitution de 1958, art 72-2 introduit par la révision du 28 mars 2003) selon laquelle les collectivités doivent bénéficier de « ressources propres ». Cependant, les collectivités ne bénéficient pas de l’autonomie fiscale, l’autorisation à lever l’impôt relève de la compétence du législateur (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, art 14). L’article 72-2 précise alors que la loi peut autoriser les collectivités à recevoir tout ou partie du produit d’impositions de toute nature et en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine . Les ressources propres représentent une part déterminante des recettes des collectivités. La loi organique du 29 juillet 2004 établit des seuils de ressources propres : ainsi au moins 62% des ressources des communes doit provenir de ressources propres, 58 pour les départements et 42,3 % pour les régions.
La fiscalité locale regroupe d’une part les impôts et taxes locaux qui constituent une source de financement importante des collectivités et d’autre part, la fiscalité nationale affectée qui représente une part notable et de plus en plus importante des ressources des collectivités :
Les impôts et taxes locaux, sont ceux qui bénéficient exclusivement aux collectivités territoriales. Il existe d’une part une fiscalité directe locale1 :
- La taxe d’habitation (TH), supprimée totalement depuis le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, demeure sur les résidences secondaires et les logements vacants (2,8 Md€ en 2023 et 3 Md€ en 2024) affectée au bloc communal.
- Les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB, 39.8 Md€ en 2023) et non bâties (TFPNB, 1 Md€ en 2023) payées par les propriétaires de terrain, dont les assiettes sont calculées à partir des valeurs locatives cadastrales affectées principalement au bloc communal. Il existe également des taxes annexes à la TFPB (environ 11 Md€), comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui représente 8 Md€ en 2023
- La fiscalité économique des collectivités est constituée de la contribution économique territoriale (CET, 16 Md€ en 2022), créée en 2010 en remplacement de la taxe professionnelle. Elle est composée de deux impositions : la cotisation foncière des entreprises (CFE, 7 Md€ en 2022, affectée au bloc communal) la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, 9 Md€ en 2022, affectée au bloc communal et aux départements). La recette de la CVAE est amenée à diminuer dans les années à venir du fait de sa suppression progressive (cf infra).
- L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) (producteurs d’électricité, propriétaires de réseaux téléphoniques, Réseau ferré). Son produit (1,6 Md€) est également partagé entre les niveaux de collectivités territoriales.
- D’autres impôts économiques existent comme la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), la taxe sur les pylônes ou la redevance des mines par exemple.
D’autre part, il existe une fiscalité indirecte locale :
- Les droits sur les mutations à titre onéreux (DMTO, 20 Md€ en 2021, 16.3 Md€ en 2023) sont principalement affectés aux départements.
- Les taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement, taxe de participation pour voirie et réseaux, taxe départementale des espaces naturels sensibles)
En parallèle, la fiscalité nationale affectée représente une part notable et de plus en plus importante des ressources des collectivités. Contrairement aux impôts et taxes locaux, la fiscalité nationale affectée ne bénéficie pas exclusivement aux collectivités, le produit n’est que partiellement reversé aux collectivités.
La fiscalité nationale affectée aux collectivités territoriales est constituée principalement :
- De fraction de TVA, versées en compensation de la suppression de la taxe d’habitation et de la réforme de la CVAE : elles se sont élevées à 52,1 Md€ en 2023 (14,1 Md€ bloc communal, 20,4 Md€ départements, 16,3 Md€ régions)
- D’accises sur les produits énergétiques (anciennement TIC, 11 Md€) en 2023, partagée essentiellement et de manière quasiment égale entre régions (5,1) et départements (5,5), une petite partie est également affectée au bloc communal (375 millions)
- De la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA, 8,3 Md€), affectée presque intégralement aux départements.
Ces impôts nationaux partagés compensent les transferts de compétences dans le cadre de la décentralisation ainsi que la disparition d’anciens impôts et taxes locaux.
La suppression récente d’impôts locaux majeurs a réduit la part de la fiscalité locale dans les ressources des collectivités :
Ces dernières années, les produits des taxes et impôts locaux et leur part dans les ressources des collectivités ont fortement diminué, passant de 98 milliards en 2020 à 68 en 2022 et à 65,2 en 2023 (Les collectivités locales en chiffres, 20242). Les pouvoirs publics ont en effet réduit la fiscalité locale des entreprises et des ménages pour soutenir la compétitivité des premières et le pouvoir d’achat des seconds. Aussi, la suppression progressive de la CVAE, avec une pleine suppression prévue au premier janvier 2030 (Loi de Finances pour 2025), constitue un vecteur de diminution des recettes fiscales pour les collectivités territoriales. En outre, entre 2018 et 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été progressivement supprimée.
Ces diminutions de ressources pour les collectivités ont quasiment toutes été compensées par de la fiscalité nationale affectée, en premier lieu de la TVA, dont une part est par ailleurs transférée à la Sécurité sociale pour équilibrer les exonérations de cotisations.
De ce fait, la structure de financement des collectivités a été profondément modifiée : le bloc communal capte aujourd’hui la majeure partie des impôts locaux avec pouvoir de taux, notamment fonciers alors que cette fiscalité locale est devenue minoritaire du financement des autres collectivités – se réduisant par exemple aux DMTO pour les départements et dont la recette a diminué ces dernières années – voire absente pour les régions. La fiscalité affectée, sans pouvoir de taux, et donc de maitrise de ces ressources, engendre une réduction des marges de manœuvre des collectivités.
Par ailleurs, la révision à venir des valeurs locatives cadastrales (VLC) pour les locaux d’habitation (logements, parkings), prévue pour 2028 (LF 2023), inquiète les collectivités. Si cette réforme revêt un enjeu de justice fiscale, notamment d’asseoir l’imposition sur une valeur proche de la valeur réelle du bien, la dernière révision générale des VLC ayant eu lieu en 1970 pour les locaux d’habitation, elle risque de redistribuer le potentiel fiscal entre collectivités et de nécessiter des mécanismes de péréquation renforcés.
La réflexion quant à la nature et aux objectifs de la fiscalité locale doit être poursuivie et amplifiée, dans la perspective d’une refonte du système de financement
Face à une complexité croissante, l’étude d’une refonte globale du financement des collectivités parait opportune. La Cour des comptes (Le financement des collectivités territoriales : des scénarios d’évolution, octobre 20223) avait notamment préconisé d’affecter la totalité du produit des impôts locaux au bloc communal comme la DMTO ou la part départementale de la CVAE afin de privilégier un lien entre l’impôt local et le service public local rendu au plus près des citoyens. Cette proposition s’inscrit d’ailleurs dans un débat plus large, celui de l’hypothèse d’une suppression des départements et le transfert de leurs compétences aux régions et aux intercommunalités (Commission sur la libération pour la croissance française, proposition 259, janvier 20084), même s’il faut souligner que cet échelon détient une légitimité historique (Décret du 22 décembre 1789 de l’Assemblée nationale constituante). Il serait également pertinent de poursuivre et d’encourager la recentralisation du RSA, comme l’expérimente la loi 3DS de 2022, afin de soulager les département compte tenu de l’effet procyclique engendré par la hausse du chômage, qui génère une hausse des dépenses de RSA et une baisse des recettes de TVA, en particulier dans certains départements.
Par ailleurs, la révision des VLC pour les propriétés non commerciales et locaux d’habitation doit être une priorité afin de rétablir une fiscalité juste et actualisée, tout en garantissant des mécanismes de péréquation renforcés, afin de limiter les écarts entre les collectivités. En ce sens, il est nécessaire de garantir l’effectivité de cette révision en 2028 et de ne pas encore une fois la reporter, la révision étant initialement prévue en 2026.
Enfin , la question du développement de la fiscalité environnementale, incitant à des comportements vertueux notamment en termes de sobriété foncière, reste ouverte (Conseil Prélèvement Obligatoires sur le ZAN et la fiscalité locale, 20225 ; Comité pour l’économie verte, 20196). De même, la Convention citoyenne pour le climat (Orientations en matière de financement, juin 20207) avait proposé de réformer la TEOM par des mécanismes plus justes et incitatifs afin de favoriser les comportements éco-responsables.
- https://www.collectivites-locales.gouv.fr/index.php/collectivites-locales-chiffres-2024 ↩︎
- https://www.collectivites-locales.gouv.fr/index.php/collectivites-locales-chiffres-2024 ↩︎
- https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20221012-financement-collectivites-territoriales_0.pdf ↩︎
- https://www.vie-publique.fr/rapport/29532-rapport-de-la-commission-pour-la-liberation-de-la-croissance-francaise ↩︎
- https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-fiscalite-locale-dans-la-perspective-du-zan ↩︎
- https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/comite-pour-leconomie-verte-les-enjeux-lartificialisation-des-sols#:~:text=Le%20comit%C3%A9%20pour%20l%E2%80%99%C3%A9conomie%20verte%20r%C3%A9unit%20les%20autorit%C3%A9s,et%20r%C3%A9glementaires%20traditionnels%2C%20de%20favoriser%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique. ↩︎
- https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/rf/ccc-rapport-final-financement.pdf ↩︎