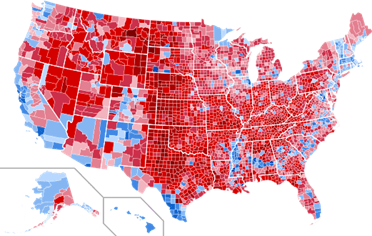Sur ce deuxième quinquennat d’Emmanuel Macron, le Sénat apparait comme une institution particulièrement solide et constructive, face à la majorité relative de l’Assemblée Nationale et ses débats extrêmement polarisés. L’absence de majorité au Palais Bourbon permet ainsi à celui du Luxembourg d’apparaitre comme une garantie la stabilité institutionnelle. Le retour en force de cette institution pourrait être l’occasion de remettre au centre du débat public son rôle fondamental, celui de représenter les territoires.
En ce sens, le Sénat plaide pour une réforme structurelle de la gouvernance territoriale, une libre-administration des collectivités territoriales, qui, inscrite dans la Constitution, peine à être réellement respectée, même si des avancées notables ont eu lieu, la plus récente étant avec la loi 3 DS de 2022.
Les différents actes de la décentralisation peuvent être vus comme une reconnaissance de la doctrine tocquevillienne. Le Premier Acte est initié avec les lois Defferre de 1982-1983, qui ont marqué un tournant historique en transférant d’importantes compétences administratives, économiques et sociales aux collectivités territoriales (régions, départements, communes). Le Deuxième Acte se concrétise avec les lois de 2003-2004, et notamment la révision constitutionnelle de 2003, qui consacre la décentralisation dans la Constitution, et reconnaît le principe de libre administration des collectivités. Le Troisième Acte né dans les années 2010 (notamment la loi NOTRe de 2015), a poursuivi cette démarche en clarifiant les compétences des différentes collectivités et en renforçant le rôle des régions.
La nécessité de réformes courageuses en matière de décentralisation se pose d’autant plus que les collectivités territoriales sont confrontées à une vague de démissions de leurs élus. Qu’elles soient le reflet d’une tâche trop chronophage ou d’un sentiment d’insécurité face aux agressions, menaces ou intimidations, ces démissions d’élus locaux témoignent d’un manque d’un manque de soutien, d’accompagnement, de formation.
Des élus locaux nécessitant un accompagnement renforcé :
Depuis la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, le droit à la formation des élus est codifié dans le Code général des collectivités territoriales CGCT (Art. L2123-12 du CGCT pour les communes, Art. L3123-10 du CGCT pour les conseils généraux et Art. L4135-10 du CGCT pour les conseils régionaux). Ainsi, pour assurer le bon fonctionnement de collectivités territoriales, le renforcement de l’accompagnement des élus locaux s’avère fondamental. Souvent issus de la société civile, ils ont besoin d’une formation tout au long de leur mandat. Avec des responsabilités élargies du fait de la décentralisation, les élus locaux sont aujourd’hui des décideurs sur leur territoire, des acteurs de changement, dotés d’un pouvoir décisionnel renforcé. Un renforcement de leur formation, accompagnée d’une augmentation de leurs indemnités pourrait contribuer à limiter les désengagements voire les démissions. En ce sens, l’autonomie des collectivités territoriales peut être assurée sans pour autant faire diminuer la présence de l’Etat dans ses territoires. En outre, la question de la professionnalisation des élus locaux se pose dans le débat public contemporain. Du Maire de village au conseiller municipal d’une métropole, beaucoup d’élus locaux sont contraints de travailler à temps partiel pour pouvoir concilier leur emploi avec leur mandat, ce qui a des conséquences directes sur leurs revenus et de manière indirecte, à plus long-terme, sur leur retraite. Pour rappel, la législation actuelle n’impose pas que le conseiller municipal soit rémunéré.
Par ailleurs, la formation actuelle est assurée par une diversité d’organismes agréés par décision ministérielle : IEP, universités, associations de maire. Cependant, cette diversité d’organismes pose question sur un manque d’homogénéité des conditions de formation des élus, entrainant alors des dérives. Cette idée est d’autant plus appuyée par le fait que certains organismes ont plus qu’une proximité avec les partis politiques. A titre d’exemple, l’Institut de formation des élus locaux (IFOREL) est directement affilié au Rassemblement National. Libération avait notamment révélé que dans le cadre de l’IFOREL, des élus RN avaient bénéficié de séminaires dans des hôtels luxueux, à la Baule notamment. Ce lien de proximité est problématique à au moins deux égards. D’abord, un organisme affilié à un parti aura peut-être tendance à dispenser une formation pouvant manquer d’impartialité, en adéquation avec la ligne idéologique du parti. Mais surtout, l’exemple de l’affaire révélée par Libération pose question au regard de l’utilisation de l’argent public, qui normalement destiné à une formation, est en grande partie allouée à un séjour aux allures de vacances. Ainsi, dans l’objectif de proposer aux élus un accompagnement de meilleure qualité, tout en poursuivant une logique d’intérêt général, un renforcement du contrôle de l’Etat sur ces organismes, bien qu’agréés, s’impose.
Revoir le mille-feuille administratif au profit de l’intercommunalité ?
Le paysage administratif français, riche de sa complexité et de ses nuances, est souvent qualifié de « mille-feuille ». Ce terme, évocateur, fait référence à la superposition des différentes couches administratives – de la commune à la région en passant par le département et l’intercommunalité. Toutefois, la pertinence et l’efficacité de cette stratification sont de plus en plus mises en doute. Le besoin de simplification, d’agilité et de proximité s’impose. À ce titre, le renforcement des compétences des intercommunalités au détriment du département apparaît selon le rapport Attali comme une solution adaptée. Le rapport Attali de 2008, dans sa décision 259, avait même préconisé la suppression du département dans un délai de dix ans, au profit des intercommunalités. Divers arguments plaidant pour le renforcement des intercommunalités peuvent être mis en avant.
Tout d’abord, l’intercommunalité favorise la rationalisation des coûts. L’augmentation des compétences des intercommunalités favorise une réelle mutualisation des moyens. Cette mutualisation pourrait conduire à une réduction des coûts grâce à une meilleure allocation des ressources, favorisant ainsi l’efficacité administrative et une meilleure gestion des deniers publics. En outre, l’intercommunalité, permet de créer un véritable lien de proximité. Avec une échelle plus réduite que le département, l’intercommunalité est en conséquence bien plus proche des préoccupations locales. Par conséquent, l’intercommunalité permet de répondre de manière plus précise et adaptée aux besoins de la population. Sa taille et sa flexibilité peuvent faire de l’intercommunalité un véritable laboratoire d’innovation afin d’expérimenter, de tester et déployer des solutions novatrices à une échelle moindre, avant qu’elles ne soient éventuellement adoptées à une échelle plus large.
Cependant, l’idée de la suppression du département (impliquant un transfert de compétences à l’intercommunalité) a été jugée trop complexe à mettre en œuvre. D’abord sur le fond, une telle suppression aurait impliqué un chamboulement de la machine administrative française. Puis, sur la forme, une telle suppression aurait nécessité une révision constitutionnelle, le département étant prévu à l’article 72 de la Constitution. Cependant, le paradigme disruptif apporté par le rapport Attali a été reconnu. En effet, à l’issue de sa publication, le département a vu ses prérogatives évoluer. S’il disposait jadis de la clause générale de compétence, celle-ci a été supprimée par la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, dite loi « NOTRE ». Désormais, seules les communes disposent de cette clause. En parallèle, la loi NOTRE a également permis le transfert de certaines compétences cette fois au profit de la région, notamment en matière de transports routiers, scolaires et ferroviaires.
La loi 3DS, fruit d’un compromis entre le Sénat et le gouvernement :
Essentiellement écrite par le Sénat, la loi 3 DS tente de répondre aux grands défis territoriaux précédemment évoqués (accompagnement des élus locaux, complexité de l’organisation administrative) mais plus généralement aux crises que le pays a traversées (gilets jaunes, Covid-19). Cette loi a fait l’objet d’intenses négociations entre le gouvernement et le Sénat. Lors de l’examen en commission mixte paritaire, 383 amendements ont été adoptés et le texte est passé de 83 à 158 articles. La loi renforce alors le pouvoir réglementaire des collectivités et ont donc plus de latitude pour fixer les règles qui relèvent de leur domaine de compétence. En ce sens, la loi 3 DS est une réponse au projet de loi constitutionnelle du 29 août 2019 visant à consacrer constitutionnellement le principe de différenciation des collectivités territoriales et visant ainsi à prolonger le droit d’expérimentation prévu à l’article 72 de la Constitution. La loi prévoit par ailleurs une recentralisation à titre expérimental du RSA dans les départements volontaires ainsi qu’un allègement des obligations déclaratives des élus locaux auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
Conclusion : Quelles pistes de réformes constitutionnelles permettant au Sénat de jouer pleinement son rôle de « Chambre des Territoires » :
Si la loi Notre ou 3DS ont révélé des avancées en matière de décentralisation, celles-ci restent limitées sur le fond comme sur la forme. Afin de sortir du flou juridique de la « libre-administration », le Sénat plaide alors depuis de nombreuses années pour obtenir un pouvoir de veto et pour la reconnaissance constitutionnelle d’une véritable autonomie fiscale aux collectivités territoriales.
Sur le Pouvoir de Veto du Sénat sur les Lois Affectant de Manière Significative les Collectivités Territoriales :
La modification des articles 44 et 45 de la Constitution est envisagée pour renforcer le rôle du Sénat en tant que représentant des collectivités territoriales. Actuellement, bien que le Sénat puisse proposer et amender des lois, il n’a pas de pouvoir de veto absolu sur la législation. En cas de désaccord entre les deux chambres du Parlement, c’est l’Assemblée nationale qui a le dernier mot. L’idée serait alors d’accorder au Sénat un droit de veto ou un pouvoir consultatif accru sur les lois qui affectent directement les collectivités territoriales. Autrement dit, si une loi était proposée ayant un impact significatif sur les collectivités, le Sénat aurait le pouvoir de la bloquer ou d’exiger que ses recommandations soient prises en compte. Dans cette configuration, le Conseil constitutionnel jouerait un rôle essentiel en déterminant la notion d' »affection significative », notamment en émettant des avis.
Sur l’autonomie Fiscale des Collectivités Territoriales :
En réponse à la suppression de certains prélèvements dont les ressources revenaient aux collectivités, une modification de l’article 72-2 de la Constitution pourrait permettre aux collectivités de prélever l’impôt directement. Les collectivités pourraient alors bénéficier d’un véritable pouvoir de création d’impôts locaux et auraient plus de liberté pour fixer les taux de prélèvement dont les ressources leur reviennent, comme c’est le cas avec la taxe foncière. Ces mesures, dans leur ensemble, serviraient à renforcer l’autonomie financière et la gestion des ressources des collectivités territoriales.
https://www.publicsenat.fr/actualites/institutions/senatoriales-2023-quel-est-le-role-du-senat
https://www.publicsenat.fr/dossier/elections-senatoriales/page/4
Tocqueville et la décentralisation – Persée (persee.fr)
Réforme constitutionnelle 2019 pour un renouveau de la vie démocratique | vie-publique.fr
Loi 3DS décentralisation déconcentration collectivités locales | vie-publique.fr
La formation des élus, l’atout bénéf du Rassemblement national – Libération (liberation.fr)